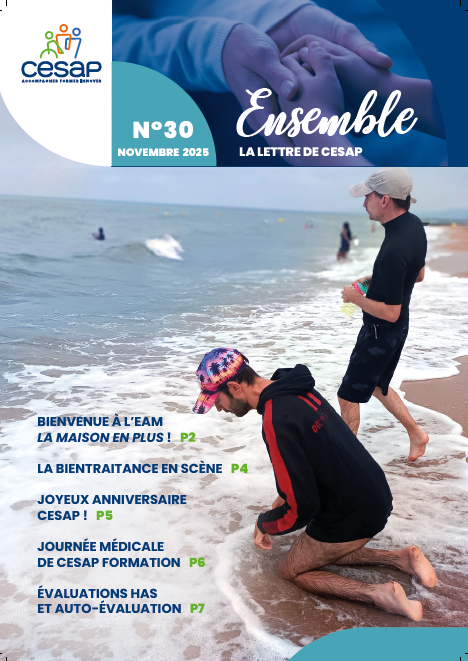La construction : 1960-1970
1965 : Création de Cesap (Comité d’Etude et de Soins aux Arriérés Profonds de la région parisienne) fut créé en 1965, avec le soutien de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sous forme associative, par un groupe de professionnels d’Ile de France, notamment médecins hospitaliers de l’APHP, avec les Dr Zucman et Tomkiewicz.
En effet dans les années 60 les enfants ayant une déficience mentale sévère, souvent associée à d’autres déficiences, restaient en famille sans soutien pour répondre à leurs besoins ou étaient recueillis dans les hôpitaux la plupart “en situation d’abandon”. D’emblée l’approche de l’association mêla étroitement éducation, soins et accompagnement social. Depuis ces temps fondateurs, Cesap va connaître de nombreux développements et transformations pour arriver à l’association que nous connaissons aujourd’hui.
Dès le départ, selon les termes de cette époque, Cesap se fixa trois objectifs : connaître et comprendre les causes et les conséquences du handicap mental sévère ; agir en faveur des enfants déficients mentaux et de leurs familles ; former les professionnels appelés à prendre en charge ces enfants ». Cela se concrétisa par trois modalités, évolutives dans le temps, mais toujours présentes aujourd’hui :
– la création et gestion de services puis d’établissements médico-sociaux, d’abord pour enfants et adolescents puis pour adultes :
furent d’abord créées des haltes-garderies et des consultations médico-sociales (SMSE) se tenant au sein d’hôpitaux pédiatriques parisiens, sur le modèle des CMPP (centre médico-psycho-pédagogique), avec une équipe d’emblée multidisciplinaire, considérant la famille comme membre actif des soins et de l’éducation de leur enfant. A partir de ces consultations, furent créés des services d’AED (aide éducative à domicile) assurés par des professionnels médico-sociaux puis paramédicaux intervenant dans les familles, proposant également des journées de regroupement à l’extérieur de la famille (les JAE-journées d’action éducative). Ces services d’AED évolueront continument pour arriver à nos actuels SESSAD (services d’éducation et de soins à domicile), présents aujourd’hui dans les 10 départements où Cesap intervient.
Un premier placement familial spécialisé (PFS) fut créé en 1967 dans l’Eure, placé tout d’abord au sein de l’’hôpital de la Roche Guyon, géré par l’APHP, puis jumelé avec le premier internat pour enfants “Les Heures Claires”, à Sainte-Geneviève-lès-Gasny, créé lui en 1968. D’autres structures furent ouvertes :
- un deuxième PFS en 1970 à Créteil ;
- un internat pour enfants et adolescents “La Montagne” à Liancourt dans l’Oise en 1970 ;
- un internat le “Château de Launay” à Reugny en Indre-et-Loire en 1973 ;
- l’ouverture du “centre d’observation et de soins” du Poujal (internat et externat) à Thiais, dans le Val de Marne, en 1974 ;
- l’accueil à Montrouge d’enfants polyhandicapés, à la pouponnière Amyot, à compter de 1977, laquelle fermera 20 ans plus tard ;
– un conseil scientifique et technique, aujourd’hui Céré (conseil des études, recherches et évaluations), combiné à un service de recherche (aujourd’hui fermé) et un centre de documentation toujours actif ;
– la création d’un centre de formation, qui concourut alors activement à la définition et à la formation au métier d’AMP (aide-médico-psychologique), aujourd’hui AES (accompagnant éducatif et social).
Le terme de polyhandicap, apparu en 1969, favorise la structuration de l’action d’équipes pluridisciplinaires associant soins et accompagnement médico-social au bénéfice d’enfants, puis d’adultes, atteints d’un handicap mental sévère associé à des difficultés motrices. Dans les années 1970; la question de la prise en charge des adultes était fort peu prise en compte.
En résumé, Les années 1960/1970 rassemble la période initiale de Cesap , pionnière, où l’intervention auprès des enfants se fait à domicile à travers des SSESAD, et dans des structures d’hébergement souvent situées à bonne distance des domiciles familiaux (internat et placement familial, puis ultérieurement MAS). Une compréhension de la problématique du polyhandicap se forge et des modalités d’éducation et de soins s’élaborent.